La lieutenant Ombeline tente d’être affectée dans la même garnison que son conjoint. Photo : Juliette Huvet-Dudouit/EPJT.
A Valdahon, dans le Doubs, les soldats de l’armée de terre doivent composer avec une ombre au tableau qui fait partie de leur carrière : l’éloignement de leurs proches. Entre mutations fréquentes, missions à l’étranger et devoir de mobilité, cette réalité façonne leur quotidien et celui de leurs familles.
Par Juliette Huvet-Dudouit
On sait en s’engageant qu’on y sera soumis », souligne le lieutenant Monrot, en exercice sur le pas de tir du camp de l’armée de terre de Valdahon, dans le Doubs. S’engager dans l’armée implique de nombreuses contraintes, parmi lesquelles l’éloignement des proches. Une réalité que le lieutenant accepte pleinement : « Je le vis bien, j’ai toujours eu l’habitude », confie-t-il avec sérénité. Originaire du sud de la France, il a passé huit ans à Grenoble en tant que mécanicien avant de devenir cadre à l’école des sous-officiers à Saint-Maixent-l’École. « Tous les militaires sont libérés à midi le vendredi pour avoir le temps de rejoindre leur famille le week-end, s’ils sont loin. Nous avons aussi une carte de réduction militaire pour les trains, valable pour nous et nos proches. »
Cependant, tout le monde ne s’adapte pas aussi bien à cette contrainte. « J’essaie de rentrer le plus possible, toutes les deux ou trois semaines maximums. Mais c’est quelque chose que je n’ai pas complètement accepté », admet le lieutenant Janel à la « popote », un lieu de rassemblement où les militaires se retrouvent pour manger et boire chaque soir sur le camp. « Je me pose la question de ce qui prime entre mon territoire et l’institution », ajoute-t-il, visiblement touché par la question. Pour d’autres, comme le lieutenant Charles-Antoine, l’éloignement est vécu différemment selon plusieurs facteurs : « Cela pèse plus ou moins selon la facilité d’accéder à ma famille. Cela dépend de la desserte en train et de la distance. »
«Nous sommes considérés comme étant en célibat géographique »
Sous-lieutenant François.
Les témoignages des plus aguerris, déjà partis en OPEX (opérations extérieures à l’étranger) pendant plusieurs mois, attestent d’un éloignement qui peut creuser un fossé irrémédiable. Une réalité qui a poussé l’armée à ajuster ses règles.
Historiquement, les OPEX menées par l’armée française avaient une durée plus longue qu’aujourd’hui, notamment avant les années 2010. À cette époque, les déploiements pouvaient facilement atteindre six mois ou plus. Depuis, la durée moyenne des missions a été réduite à quatre mois, dans un souci de mieux équilibrer vie professionnelle et vie familiale. Cette évolution s’inscrit dans une politique de fidélisation des militaires, visant à limiter les impacts psychologiques et physiques des longs déploiements.
La Loi de programmation militaire 2024-2030 met également l’accent sur l’amélioration des conditions de vie des soldats et sur l’adaptation des déploiements aux enjeux humains.
Au-delà des missions extérieures, les mutations régulières et non choisies, parfois tous les trois ans, ajoutent à cette complexité. « Lorsque nous sommes affectés dans un lieu éloigné de notre conjointe, nous sommes considérés comme étant en célibat géographique », résume le sous-lieutenant François. L’éloignement est souvent perçu comme une barrière émotionnelle, rendant parfois difficile l’investissement total dans la vie militaire.
Interférence moderne
« Internet ne marche pas toujours bien pendant les missions, ce qui rend les échanges difficiles. Mais d’un autre côté, cela nous permet de rester connectés, même de loin », explique le lieutenant Monrot. Les nouvelles technologies, censées réduire l’impact de l’éloignement, ne sont pas toujours une solution idéale. « Les communications incessantes peuvent devenir problématiques. On a des militaires qui passent beaucoup de temps à appeler leurs familles, au détriment des liens avec leurs camarades. Cela peut nuire à la cohésion », remarque le lieutenant Virgile.
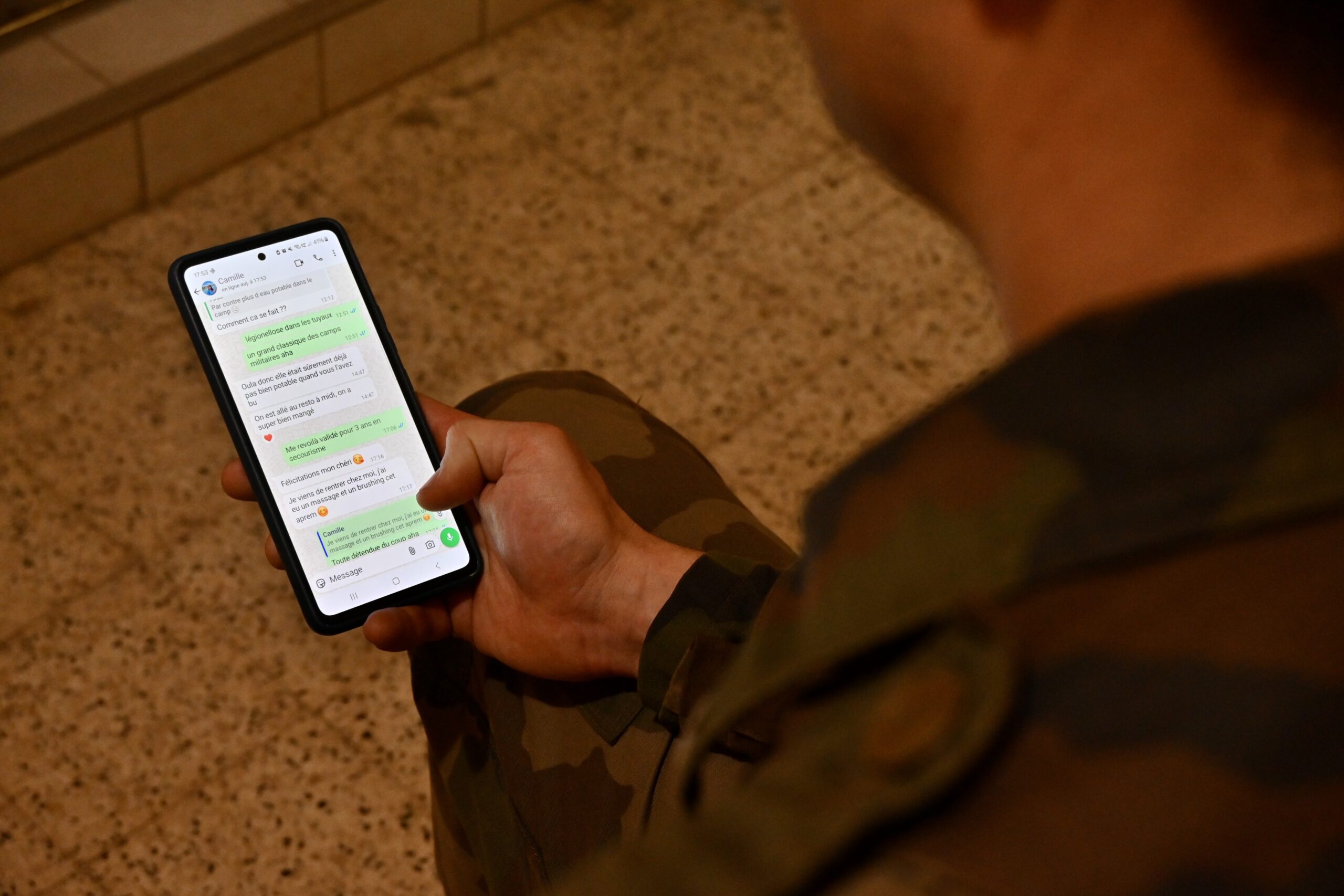
Les lieutenants tiennent au courant leurs familles de ce qu’il se passe sur le camp. Photo : Juliette Huvet-Dudouit/EPJT.
Accoudé sur une table près de la salle d’exercice de tir virtuel, il avoue préférer les méthodes plus traditionnelles : « Avec ma femme, nous nous écrivons des lettres pour rendre nos échanges plus significatifs. »
Pour autant, ces technologies facilitent certains aspects de la vie militaire. « Elles permettent de garder un lien, même si cela ne remplace pas une présence physique », souligne le sous-lieutenant François. Mais il admet aussi un sentiment d’impuissance difficile à gérer : « Pendant une mission, ma femme a eu un problème avec la voiture. Ne pas pouvoir intervenir ajoute un stress inutile. »
Cette omniprésence technologique a aussi des effets pervers. « Psychologiquement, certains militaires restent chez eux, à distance. Ils passent beaucoup de temps à entretenir des liens familiaux et pas assez à se concentrer sur leur mission », déplore le lieutenant Virgile. Cette difficulté à se déconnecter peut peser sur l’efficacité individuelle et collective.
Quelques chiffres sur les membres de l’armée et leurs proches. Réalisation : Juliette Huvet-Dudouit/EPJT
Les femmes, en première ligne face aux contraintes

Avec 16,8 % de femmes, les armées françaises sont en effet les 4 ème les plus féminisées au monde après Israël, la Hongrie et les Etats-Unis. Photo : Juliette Huvet-Dudouit/EPJT.
« J’ai envie d’avoir une vie à côté. Je ne ferai peut-être pas ça toute ma vie », partage le lieutenant Charlotte, accoudée à une table en bois de la « popote ». Elle évoque également les discussions entre femmes militaires, souvent marquées par des préoccupations familiales et la difficulté de concilier carrière et vie personnelle. Assise en face d’elle, le lieutenant Ombeline, dont le conjoint est également militaire, note les compromis nécessaires : « On essaie d’être affectés au même endroit, mais pas dans le même régiment. Pour l’instant, nous n’avons pas d’enfants, mais si cela arrive, nous envisagerons peut-être qu’un de nous quitte l’armée. »
Ces problématiques compliquent la fidélisation des femmes à la profession. « La question familiale est un sujet central, surtout pour les femmes qui occupent des postes à responsabilité », explique le lieutenant Charlotte. Ces contraintes semblent peser davantage sur elles, notamment lorsqu’il s’agit de gérer une double carrière ou d’élever des enfants.
« C’est pour partir que j’ai signé »
Malgré ces obstacles, l’éloignement reste aussi une source de motivation pour certains. « C’est pour ça que j’ai signé. J’aime partir en opération, découvrir de nouveaux horizons », déclare le lieutenant Monrot. Après plusieurs missions, dont trois fois l’opération Barkhane et deux opérations au Mali, il ne regrette pas son choix.
Pour d’autres, cependant, cette vie à distance finit par peser. « C’est compliqué de construire quelque chose avec une compagne civile, surtout si elle a un métier fixe. Nos vies sont rarement alignées », confie le lieutenant Maxime. Aujourd’hui âgé de 32 ans, il aspire à une stabilité qui lui permettrait de fonder une famille. « Les civils ont souvent du mal à comprendre le rythme et les contraintes », ajoute-t-il.
« Le militaire qui n’est pas prêt à partir ne peut pas vraiment s’épanouir dans ce métier »
Sous-lieutenant François.
La tension entre le devoir militaire et la vie personnelle est au cœur de nombreuses décisions de carrière. « Le militaire qui n’est pas prêt à partir ne peut pas vraiment s’épanouir dans ce métier », résume le sous-lieutenant François. Mais cette volonté de partir n’est pas toujours permanente. « À terme, on espère retrouver une stabilité. En attendant, on s’adapte », conclut le lieutenant Janel.
Pour ces femmes et ces hommes en uniforme, l’éloignement est une épreuve constante, mais aussi un moteur dans leur engagement. Entre sacrifices personnels, évolutions technologiques et espoirs de rapprochement, chaque militaire compose avec cette réalité, souvent au prix de grands compromis.

Juliette Huvet-Dudouit
juliettehd6 sur X ou bluesky
24 ans
Étudiante en journalisme à l’EPJT.
Passée par Ouest-France locale de Granville et du Mans
Souhaite devenir journaliste d’investigation.
